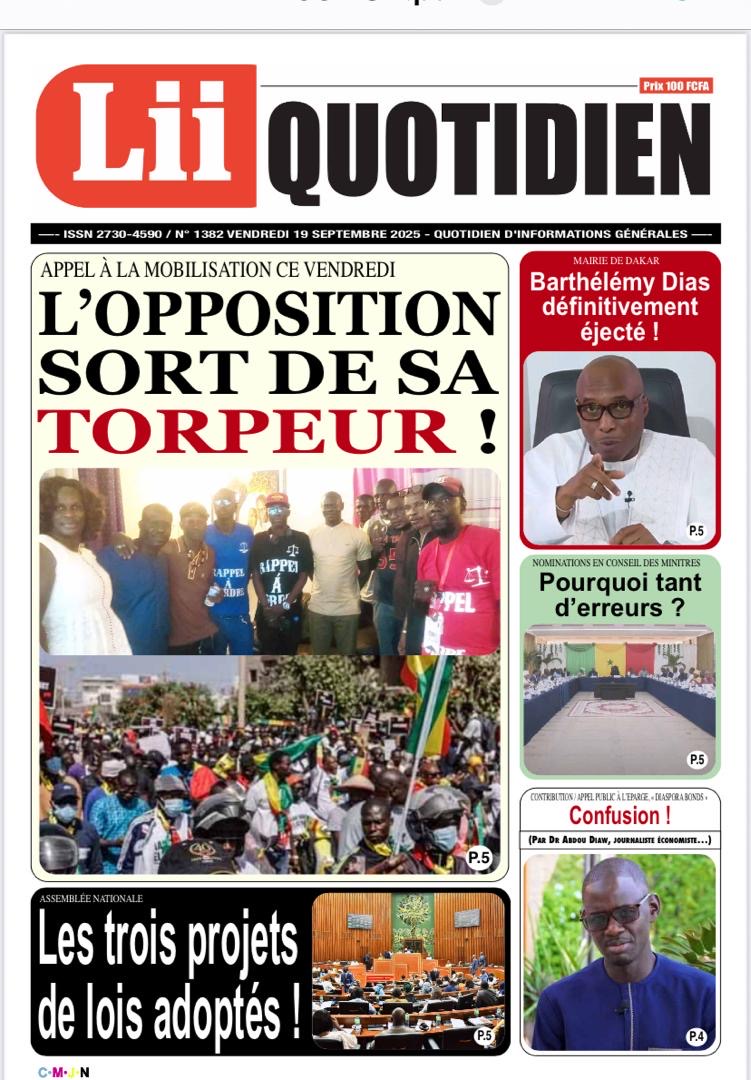Par Pr Kalidou Diallo, ancien ministre De l’Education Nationale
Le parrain du Concours général sénégalais, André SONKO, à la tête du grand ministère de l’éducation nationale de 1993 à 2000, homme de consensus et de paix, dans un contexte de mutations syndicales et de multiples crises, économiques, scolaires et universitaires.
André SONKO, né le 4 février 1944 à Ngazobil en pays Serer, titulaire d’un master en sciences économiques à l’UCAD et d’une maîtrise en Administration publique à l’université de Californie est un administrateur civil qui a occupé plusieurs fonctions dans l’État et dans le secteur privé de l’éducation. Il fut tour à tour Directeur du Bureau Organisation et méthodes de la présidence de la République du Sénégal, Secrétaire général du gouvernement, ministre de la fonction publique, de l’emploi et du travail, ministre de l’intérieur, ministre Secrétaire général de la présidence de la République, ministre de l’éducation nationale, Directeur général de Suffolk University Dakar Campus et actuellement directeur du Cours Sainte Marie de Hann depuis septembre 2016.
C’est en tant que syndicaliste, secrétaire permanent chargé de la coordination du SUDES et porte-parole de l’intersyndicale de l’enseignement et principal négociateur à côté de mon ami feu Ousmane Sow de l’UDEN que j’ai connu le ministre de l’éducation nationale, André Sonko. D’adversaire au sens syndical du terme nous sommes devenus amis durant les sept ans qu’il a passés dans le système.
J’ai eu l’honneur de porter l’écharpe, par ses soins, de Chevalier de l’ordre national du Lion en 1997, par décret de Monsieur le Président de la République du Sénégal de l’époque, Abdou Diouf. Cette amitié se poursuit encore aujourd’hui.
Cet homme affable, ministre serein dans la tourmente et sage dans la tempête des grèves scolaires et universitaires a su faire de la fonction ministérielle un sacerdoce. Ils furent, Ahmadou Makhtar Mbow , IBA Der Thiam et lui, André SONKO, des modèles pour moi, chacun dans un aspect précis du domaine où il excelle.
Il fut nommé dans le gouvernement de Habib Thiam dans un contexte de gouvernement de majorité présidentielle élargie mais surtout de crise budgétaire grave et de bouillonnement syndical généralisé.
Des crises multiformes jalonnent le système éducatif
La crise économique s’est déclarée au milieu des années 1970 (sécheresse et augmentation du prix du pétrole) et les premières mesures de redressement dans le cadre du Plan d’ajustement structurel (PAS) de 1979.
Durant les années d’ajustement, l’éducation nationale fut sevrée : blocage des recrutements, départs volontaires, classes à doubles flux ou multigrades, suppression des internats, des écoles normales régionales de formation des enseignants de qualité en 4 ans et création des EFI à la place, avec formation en une années puis recrutement des vacataires sans formations préalables dans le moyen secondaire en 1992 et création du projet des volontaires en 1995 sans compter les enseignants appelés « ailes de dindes ».
Le système éducatif à travers les ministres qui se sont succédé dans le secteur de 1980 à 2000 (Abdel Kader Fall, Iba Der Thiam, Ibrahima Niang, Djibo Leyti KA, André Sonko), à subi le poids des PAS de la Banque mondiale et du FMI. André Sonko a traversé la période la plus difficile avec la perte du soutien des syndicats de la participation responsable dans l’enseignement et celle de la CNTS en crise, elle aussi.
Un syndicalisme autonome a pris forme
En effet le SUDES, le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS), le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES), le Syndicat autonome des travailleurs de la justice (SATJUS), le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), le Syndicat démocratique des techniciens du Sénégal(SDTS), l’Union des travailleurs du Sénégal (UTS), le Syndicat unique des travailleurs de la SOTRAC (SUTS, le Syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications (SNTPT), l’Union démocratique des enseignants (UDEN), se réunissent et
créent la Coordination des syndicats autonomes (CSA) en face de la CNTS dirigée depuis 1982, avec le triomphe de la ligne du Renouveau syndical, par Madia Diop.
Ces organisations adeptes de l’indépendance et de l’autonomie syndicales se concertent et décident de convoquer une conférence syndicale unitaire le 16 février 1990 au siège du SUTELEC. Des divergences profondes surgissent entre deux groupes sur principalement les rapports avec la CNTS qui est adepte de la participation responsable.
Finalement le SUTELEC, l’UDEN, le SUTSAS, le SNPT et le SAES optent pour la création d’une centrale autonome alternative à la CNTS et d’autres comme le SUDES, le SDTS, le SUTS, l’UTS partisans d’une coopération et unité d’action avec la CNTS, continuent dans un cadre confédéral à travers la CSA qui se rapproche de la centrale gouvernementale. Les deux organisations négocient ensemble avec le patronat et le gouvernement et obtiennent l’autonomie de gestion, l’IPRES et la caisse de sécurité sociale avec une présidence tournante des conseils d’administration des deux institutions.
Le SYNPICS non aligné entre ces tendances reste un syndicat professionnel libre indépendant de toute centrale ou confédération syndicale. Après quelques mois d’actions communes marquées par la première grande grève du SUTELEC en 1990 sous la direction de Mademba Sock qui a fini d’imposer ses marques, de rentre incontournable son organisation, pour la fourniture normale de l’électricité au Sénégal. C’est revigoré par cette victoire du SUTELEC et renforcé par les acquis du SAES dans le supérieur que le premier groupe partisan d’une centrale combattante et opposée radicalement à la ligne « participationniste » se réunit en congrès constitutif de l’UNSAS.
Avec la gravité du déficit budgétaire, le gouvernement avait institué l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) puis la taxe complémentaire de 5%. Ce qui provoqua la grève de décembre 1990, suivie des négociations avec le retrait de la taxe de 5%. La crise s’est poursuivie avec le plan Sakho/Loum jusqu’à la grève générale et la journée morte du 2 septembre 1993 avec l’ensemble des syndicats du Sénégal. Malgré le recul du gouvernement sur plusieurs questions, l’UNSAS poursuit des plans d’action avec le mot d’ordre « Ne touche pas à mon salaire » jusqu’à la dévaluation de 50% du franc CFA par les autorités françaises, le 11 janvier 1994.
Le processus de privatisation de la Senelec demandée par le bailleurs de fonds et rejeté principalement par le SUTELEC avait abouti à la signature du protocole d’accord de 1997, non respecté par le gouvernement et cela a conduit à la démission du ministre de l’économie et des finances, Pape Ousmane SAKHO, considéré comme l’homme des Institutions de Bretton Woods. Il fut remplacé par Mamadou Lamine LOUM.
Crise de la participation responsable
Avec la création de la CNTS et l’instauration de la participation responsable au lendemain de la grève générale de 1968, Senghor a été à l’abri des grèves générales jusqu’à son départ du pouvoir le 31 décembre 1980.
Le mandat de Abdou Diouf a débuté avec le manifeste du renouveau syndical avec le leadership de Madia Diop, combattu de l’intérieur par le Parti socialiste. Après le congrès de la CNTS des 17 et 18 avril 1982 avec l’élection de Madia Diop à la tête de la centrale, le FROLUDES (Front de lutte pour la démocratie syndicale fut créé au sein de la CNTS et dirigé par Aliou Sow qui fut exclu en mars 1984. Le PS refuse d’entériner et s’en suivent les affrontements du 20 juillet 1984 au siège de la centrale avec la mort de Daouda Ngom permanent syndical.
Les ministres et députés du régime créent le comité de redressement syndical (CRS) sous la direction de Fambaye Fall Diop ministre de l’enseignement technique. La coordination FROLUDES/ CRS fut créée. Finalement Aliou Sow est exclu de la CNTS et du Parti socialiste en 1987
Le congrès extraordinaire du Parti socialiste de 1989 supprime le Comité syndical CNTS/PS laissant Abdou Diouf comme seul interlocuteur de Madia Diop tenté de plus en plus par l’autonomie syndicale face à la gravité de la crise économique qui frappe les entreprises, accompagnée de licenciement et de la baisse du pouvoir d’achat des ménages. Sa centrale est bousculée aussi par ses concurrents, partisans de l’autonomie syndicale l’UNSAS et la CSA principalement. Dans ces conditions, la CNTS avec ses branches dans l’enseignement entrent dans la série des luttes syndicales des années 1990 dans le cadre de la lutte contre le plan d’urgence Sakho/Loum.
C’est à ce moment qu’ André Sonko entrait au ministère de l’éducation nationale en juin 1993 avec pape Ousmane Sakho.
Avec la gravité du déficit budgétaire, le gouvernement avait institué l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) avec la taxe complémentaire de 5%. Ce qui provoqua une série de graves syndicales qui s’est aggravée avec le vote du plan d’urgence ou plan Sakho/Loum
Une grève générale avec un succès sans précédent avec le slogan « Touche pas à mon salaire accompagnée d’une journée morte le 2 septembre 1993 fut lancée par l’ensemble des centrales syndicales du Sénégal sous la direction de Madia Diop (CNTS), Iba Ndiaye Diadji (CSA) et Mademba Sock (UNSAS)
Cette instabilité s’est poursuivie jusqu’à la dévaluation du franc CFA de 50% intervenue le 11 janvier 1994.
Crise scolaire et universitaire
Le rapprochement SAES/SUDES en octobre 1988 a permis l’élaboration d’une plateforme commune dans le supérieur avec un plan d’action unitaire le 6 et le 22 décembre 1988.
Le préavis déposé en janvier 1989 ouvre une série grèves en février, mars, mi-avril et des négociations ayant provoqué l’audience du 18 avril 1989 avec le président Abdou Diouf
Résultats obtenus
- l’augmentation du budget de l’enseignement supérieur
- la construction et l’équipement de nouveaux locaux
- l ’ouverture de l’université de Saint-Louis
- l’extension de la bibliothèque université de l’UCAD
- l’affectation de nouveaux locaux à l’UCAD (Camp Jeremy, BRGM)
- l’augmentation de la prime de recherche de 55 à 75000 F
Le SUDES lève son mot d’ordre car il y’avait des acquis pour les enseignants du primaire et moyen secondaire avec l’indemnité d’enseignement qui passe de 20 à 30% et celle du logement de 25 à 35 000 F et le SAES continue pendant tout le mois de mai et obtient la création d’une indemnité spéciale de recherche formation représentant 35/% du salaire indiciaire pour tous les enseignants du supérieur.
La revendication sur les franchises universitaires a été versée aux débats de la concertation nationale sur l’enseignement supérieur qui a regroupé tous les partenaires de l’université à partir de septembre 1992.
23 mesures ont été adoptées par consensus puis validées par le conseil interministériel du 9 décembre 1993 sauf l’élection du recteur et la création d’une chancellerie.
Ces accords constituent la base des lois 94-75 du 24 novembre 1994 relative à l’université de Dakar et la 94-79 du 24 novembre 1994 sur les franchises universitaires qui excluent de nouveau les cités et résidences universitaires.
Parallèlement, les autorités faisaient face aux revendications de la CED. L’absence d’accord provoqua l’année invalide en 1994 et la prise de mesures sévères contre les étudiants: l’exclusion de tous les cartouchards et de tous les redoublants du 1er cycle, l’expulsion de la cité universitaire de tous les étudiants et l’application de nouveaux critères fixés unilatéralement par le COUD (suspension des bourses de tous ceux qui, à cause de l’année invalide ont redoublé de fait, la privatisation des restaurants universitaires, la suppression du ticket subventionné à tous les étudiants non boursiers, le bannissement définitif de toute notion de triplement de cartouchard dans le premier cycle).
Frappés de stupeur par la dissolution de leur organisation, les conséquences de l’année invalide et ces mesures indiquées ci-dessus, les étudiants sont restés léthargiques dans les contestations habituelles pendant au moins 2 ans avant de se réveiller violemment en mars 1997 avec la naissance du Comité de gestion de crise ( CGC).
La violence reprend à l’UCAD et l’UGB malgré des acquis jusqu’après l’alternance avec la mort de Balla Gaye en janvier 2001.
André Sonko, avec toutes ces difficultés a joué un véritable rôle de sapeur-pompier en contribuant à l’extinction de tous les feux dans ce contexte, grâce à son calme olympien, son sens de l’humain, sa compréhension des enjeux de l’éducation et surtout, un grand sens de l’écoute.
En tant que ministre de l’ensemble du système éducatif, il a été le principal acteur durant toute la période de son magistère (1993-2000).
Oui, cet homme modeste, ce ministre dans la tourmente, ce sage dans la tempête, comme déjà dit, reste un modèle dont l’exemple doit inspirer les générations actuelles.
Je félicite Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République, d’avoir retenu ce choix sur des propositions de mon ami et collègue, Monsieur le ministre Moustapha Mamba Guirassy.
André SONKO fut ministre quand tout semblait être dans la tourmente, quand tout « se cassait »— l’économie, la politique, les voix de l’université, les classes désertées — mais cela n’a jamais cassé l’homme en lui.
Il est resté debout, fidèle à lui-même, comme un vieux baobab dans la poussière du Sahel, dont les valeurs incarnées peuvent constituer une guidance pour la jeunesse apprenante dans un contexte où l’avènement du numérique et de l’Intelligence artificielle requière la référence à l’éthique et aux valeurs humanistes.
Kalidou Diallo, historien du mouvement syndical,
Ancien secrétaire général du SUDES,
Ancien ministre conseiller sur les syndicats à la présidence la République
Ancien ministre de l’Éducation nationale
Chevalier de l’Ordre national du Lion
Champion UNGEI (l’Initiative des nations unies pour la scolarisation des filles)
Dakar le 31 juillet 2025