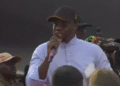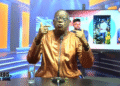À l’instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la fraternité humaine organisée la première semaine de février de chaque année comme moyen de promouvoir l’harmonie entre toutes les religions, croyances et confessions, sera célébrée ce mardi 4 février.
Par Idrissa NIASSY
En décembre 2020, alors que le monde devait affronter les conséquences d’une crise sans précédent provoquée par la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 4 février Journée internationale de la fraternité humaine. Cette journée célébrée pour la première fois en 2021, permet de sensibiliser sur les différences cultures et religions ou convictions et de souligner le rôle important de l’éducation dans la promotion de la tolérance. C’est pourquoi, l’éducation, en particulier celle qui est dispensée à l’école, devrait contribuer véritablement à promouvoir la tolérance et l’élimination de la discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Dans cette perspective, il est nécessaire d’encourager les activités destinées à promouvoir le dialogue entre les religions et les cultures, afin de renforcer la paix, la stabilité sociale, le respect de la diversité et la compréhension mutuelle. La tolérance, le pluralisme, le respect mutuel et la diversité des religions et des convictions font en effet prospérer la fraternité humaine.
Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été entreprises aux niveaux international, régional, national ou local. Des actions ont également été menée par les chefs religieux pour promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel. Une rencontre a notamment eu lieu entre le pape François et le grand imam d’Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, le 4 février 2019 à Abou Dhabi, à l’issue de laquelle a été signé le document intitulé «La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune».
La culture de la paix peut être définie comme l’ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur : le respect de la vie, le rejet de la violence et la promotion et la pratique de la non-violence par l’éducation, le dialogue et la coopération ; le respect des principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États et de la non-intervention dans les questions qui relèvent essentiellement de la juridiction nationale de tout État quel qu’il soit, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international ; le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et leur promotion; l’engagement de régler pacifiquement les conflits ; les efforts déployés pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Il peut également être défini par le respect et la promotion du droit au développement ; le respect et la promotion de l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes ; le respect et la promotion du droit de chacun à la liberté d’expression, d’opinion et d’information ; et enfin, l’adhésion aux principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, de solidarité, de coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les niveaux de la société et entre les nations et encouragés par un environnement national et international favorisant la paix.
En 1999, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, par sa résolution 53/243, la Déclaration et le Programme d’action sur une culture de la paix, qui constituent le mandat universel de la communauté internationale, en particulier du système des Nations Unies, de promouvoir une culture de la paix et de non-violence qui profite à toute l’humanité, y compris aux générations futures.