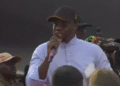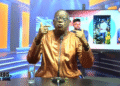La mangrove au Sénégal joue un rôle écologique, économique et social fondamental, notamment dans les zones côtières comme le delta du Saloum et la Casamance. Cependant, elle fait face à de nombreuses menaces dont les populations seront les principales victimes.
Par Idrissa NIASSY
Un écosystème fragile mais vital, la mangrove sénégalaise est aujourd’hui plus que jamais menacée par les activités humaines dont les plus visibles sont : la déforestation avec la coupe abusive du bois, les pratiques agricoles, l’exploitation du sel ; le changement climatique ; la pollution dans toutes ses formes ; la pression sur les ressources halieutiques, comme la surpêche, les pratiques de pêche destructrices, comme l’utilisation d’explosifs dans certaines zones ; et l’urbanisation avec la construction de routes et barrages, ce qui perturbe la circulation naturelle de l’eau douce et salée nécessaire à l’écosystème. Selon le Colonel Mamadou Sidibé, Directeur des Aires marines protégées (Amp), avec toutes ces menaces, « il est important de juguler ces écosystèmes de mangroves », tout en saluant l’initiative des communautés de créer des Aires marines protégées pour non seulement conserver, mais pour lutter contre ces désagréments.
C’est pourquoi, pour faire face à toutes ces risques, la Direction des Aires marines communautaires protégées organise les 21,22 et 23 juillet 2025, un colloque international sur les écosystèmes de mangroves, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet Natur’ELLES, Socodevi, en collaboration avec les partenaires comme l’Uicn, Climate Partners, Iisd, Nebeway, entre autres.
Ce colloque se propose comme un espace de dialogue inclusif et interdisciplinaire du milieu de la recherche avec des chercheurs, décideurs, acteurs communautaires, Organisation de la société civile et l’ensemble des publics autour des écosystèmes de mangroves. Il vise également à mieux comprendre leur rôle écologique, socioéconomique et climatique, tout en mettant en avant les mécanismes innovants de paiement pour services environnementaux, dont le charbon bleu, comme leviers de conservation, de résilience climatique et de développement durable des territoires côtiers.
Pour lui, les écosystèmes de mangroves, dont le Sénégal dispose de deux similaires, jouent un rôle extrêmement important d’abord un rôle de protecteur, un rôle nourricier, mais aussi un rôle sanitaire, écologique, etc. « Ce qui fait que, aujourd’hui, la protection des îles qui sont autour de ces écosystèmes de mangroves prouve vraiment déjà que ces écosystèmes jouent un rôle extrêmement important pour la protection de ces îles », explique-t-il.
Avant de faire savoir que ces écosystèmes-là ont fait vivre plusieurs générations d’enfants en payant leurs écoles, leur santé. Ce qui leur a permis d’être là aujourd’hui. Il s’agit du Delta du Saloum et celui de la Casamance sont similaires du point de vue salinité et le Delta du fleuve Sénégal et celui du fleuve Gambie qui sont aussi similaires du point de vue d’eau douce. D’après lui, c’est ce qui fait « le charme de ces deux écosystèmes de mangroves qu’on a au Sénégal et qui sont à peu près un peu différents ».
Jean Philipe Marco Directeur de Socodevi, prenant la parole, a indiqué que ce projet socioéconomique place les femmes au cœur des stratégies régionales, tout en protégeant les patrimoines naturels essentiels des mangroves. « Elles constituent un barrage naturel, un registre pour la biodiversité, un endroit pour la pêche, tout en rendant du bien pour les services essentiels », a-t-il déclaré.
« Le Canada s’engage activement à la protection des écosystèmes de mangroves à l’échelle nationale et internationale notamment avec le flux de financement », a indiqué le Chargé d’affaires de l’Ambassade du Canada. Pour lui, le pays qu’il représente, travaille conjointement avec le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l’Environnement sur plusieurs initiatives dont le projet Natur’ELLES, qui vise à renforcer la résilience des écosystèmes marins, des zones côtières du Sine Saloum et de la Casamance, l’adaptation du changement climatique des communautés qui vivent de la conservation de ces biodiversités. « En travaillant ensemble, nous pouvons devenir plus efficaces, en partageant les connaissances, les ressources, les meilleurs pratiques pour soutenir les écosystèmes marins », a-t-il conclu.