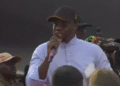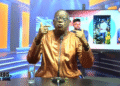La Conférence d’Alma Ata était la première conférence internationale consacrée aux soins de santé primaire organisée par des instances des Nations Unies à l’occurrence l’Oms, et réunissant près de 140 pays, dont les États-Unis. Mais depuis lors, on constate qu’il n’y a aucune avancée dans ce domaine, rien que des déclarations.
Par Idrissa NIASSY
En 1978, la Déclaration d’Alma-Ata, au Kazakhstan, issue de la Conférence sur les soins de santé primaires et la valorisation des ressources de la médecine traditionnel, a mis en évidence l’importance des soins de santé primaires comme moyen d’accéder à un niveau acceptable de santé pour tous. L’initiative était ambitieuse. Mais depuis lors, on constate qu’il y a aucune avancée dans ce domaine. Que des répétitions de la part de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) à travers des déclarations que les pays n’exploitent pas pour les adapter à leur pays.
Selon le Professeur Rokia Sanogo, Directrice générale de l’Institut nationale de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles du Mali, L’Oms ne peut pas agir à la place des places. « Elle donne des directives, donne des conseils, renforce les capacités des pays, mais il revient au pays pour d’intégrer leurs stratégies, les ressources de la médecine traditionnelle dans leur politique de santé », a-t-elle fait savoir. Et de poursuivre : « une qu’ils ont leurs programmes, les États doivent mettre des financements, un plan opérationnel pour que ça soit exécuté.
Mais malheureusement, depuis 1978, il n’y a que de très belles déclarations, de très belles dispositions, mais qui ne sont pas appliquées au niveau des pays ». Elle intervenait lors de la Journée scientifique du Forum Galien Afrique tenu le vendredi 31 octobre 2025, au King Fahd Dakar. Pour elle, l’Oms ne peut pas faire de l’ingérence au pays. Elle ne fait que des recommandations, que les pays doivent adapter à leurs politiques nationales, au système local et pour qu’il y ait la contribution des ressources de la médecine traditionnelle dans la santé.
Au Sommet mondial de la médecine traditionnelle en Inde tenu en septembre 2025, où elle a pris part, le Professeur Sanogo d’indiquer que l’Oms a adopté la nouvelle stratégie mondiale de la médecine traditionnelle. « Durant ce Sommet, il a été clairement dit que sans la prise en compte des ressources de la médecine traditionnelle, il n’y aura pas de couverture sanitaire universelle. Ça a été dit par le Directeur général de l’Oms, ça a été dit par tout le monde, mais dans la pratique, ce n’est pas exécuté », a-t-elle expliqué.
La Directrice générale de l’institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles du Mali a profité de cette tribune pour montrer son désaccord sur la non évaluation de l’apport de nos États concernant le financement de la santé, qui sont devenus tellement dépendants de l’extérieur. Alors que chaque pays a une politique nationale, a un budget, et chaque pays a ses propres initiatives. « Aujourd’hui, il serait intéressant, quand on revoit la question du financement de la santé, d’écouter des expériences de communautés qui, au niveau local, sont organisées, avec des diasporas qui ont fait des centres de santé, qui envoient les médicaments. Avec des expériences de ce genre, la société civile doit être présente », dit-elle. Avant de faire savoir que la solution à cette problématique, c’est de redonner la force à l’État qui a l’obligation d’organiser un système de santé.
Parlant de la souveraineté sanitaire, cette dernière de faire part que seul l’États est habilité sa politique sanitaire et non les partenaires. « C’est l’État qui doit dire, si vous voulez intervenir dans mon pays, vous faites comme ça », a-t-elle développé. En Afrique subsaharienne le Rwanda l’a réussi et on attend à ce que d’autres pays fassent pareil.
En tant que Coordonnatrice du Programme pharmacopée et médecine traditionnelle du Cames, qui se charge de recherche, d’innovation pour la production et la commercialisation des médicaments à usage humain et vétérinaire issus de la pharmacopée africaine, elle invite les tradipraticiens à produire d’abord les médicaments qui ont une autorisation, comme le Balimbo qui a été lauréat du Galien en 2020, et le Faka contre la drépanocytose, qui a été lauréat du prix Macky Sall. « l’Afrique de l’Ouest a du potentiel. On a un grand nombre de produits qui ont une autorisation de mise sur le marché. Aujourd’hui, il nous faut mettre en place une recherche action, une recherche appliquée, pour qu’on utilise ces produits dans un cadre contrôlé avec les médecins », a-t-elle conclu.
En Afrique, si nous voulons la valorisation de la médecine traditionnelle, les confusions entre tradipraticien et médecin doivent cesser. Que chacun joue son rôle pour créer une collaboration entre le système traditionnel et le système conventionnel pour la santé.